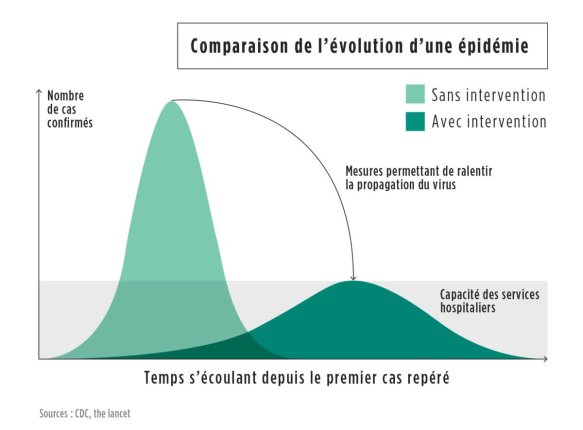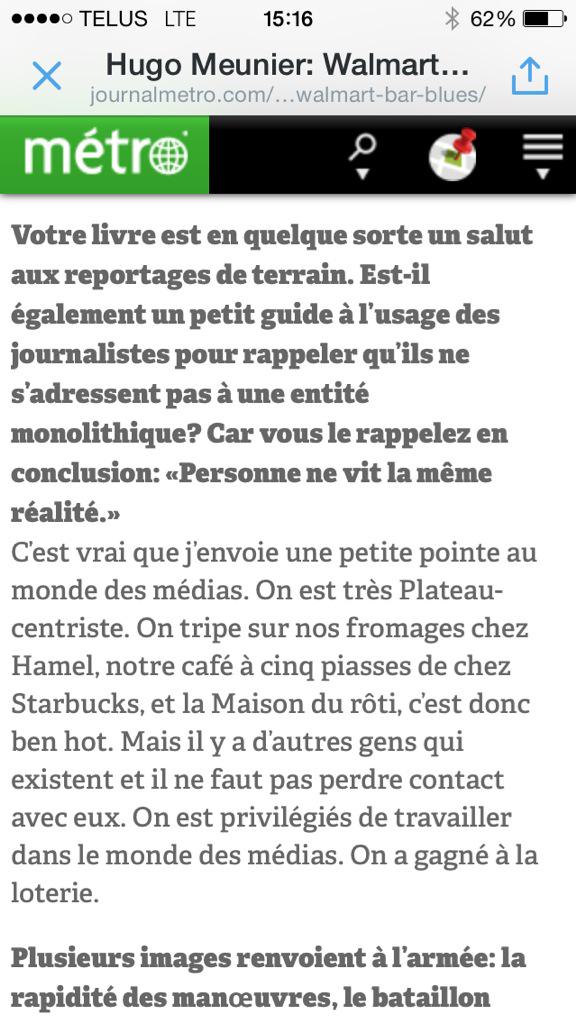Le Cercle de Vienne, c’est un groupe de penseurs qui se sont réunis dans les années 20, pour échanger – et dont Wittgenstein fut une des figures les plus marquantes (bon, oui, Popper, mais c’est mon billet, j’ai le droit d’avoir mon chouchou, bon).
C’est un prof d’épistémologie qui m’a fait découvrir le Cercle. Vous savez, un de ces profs inspirants dont la stature intellectuelle n’a d’égale que l’humanité débordante? Un de ceux-là. C’est aussi le prof qui dit qu’une bonne thèse, c’est une thèse terminée – mais je m’égare. Ce prof donc, a semé en nous le germe du Cercle de Vienne, l’idée de faire vivre les débats qui animent les séminaires à l’extérieur des salles de classe, pour continuer à confronter nos idées, à nourrir nos réflexions une fois que la scolarité serait terminée. « Nous », c’est mes collègues du doctorat et moi. Ceux avec qui j’aspire au titre de PhD.
Parce que le doctorat est, après la scolarité, un acte solitaire, nous avons copié l’idée du Cercle de Vienne, et décidé d’en faire quelque chose comme un acte solidaire. Nous nous sommes trouvés parce que nous partageons un certain amour du savoir, de la recherche, et bien entendu, de la gestion dans son sens le plus large – la conduite des hommes et l’administration des choses.
Nous partageons aussi une certaine vue de ce monde académique à la fois innovant, mais tellement rigide, avec ses rites de passage barbares, ses codes, ses mythes. Un univers en soi, que nous avons choisi d’investir à notre façon.
Nous sommes un groupe des plus hétérogènes : hommes et femmes, quelque part entre 24 et 52 ans, ingénieurs, sommelière, avocat, gestionnaires, enseignants. Animés par l’éthique, la prise de décision, l’innovation ou la RSE, dans les organisations sportives, culturelles, de santé, communautaires. Nous sommes français, québécois, canadiens, algériens, marocains. Nous sommes de Concordia, Ottawa, HEC, ESG-UQAM.
Nous nous connaissons peu en dehors des séminaires, mais pourtant nous connaissons les uns des autres une dimension à laquelle peu de gens de nos familles ont accès. En nous fréquentant dans des périodes de grande intensité où nos réflexions de doivent d’être aiguisées, nous avons eu accès à une dimension de l’être qui ne se dévoile qu’en de tels moments. Un endroit à l’intersection de la connaissance, de l’identité, de la culture et de l’espoir. Parce que pour articuler correctement des idées, il ne suffit pas d’avoir lu – encore faut-il que les idées résonnent en soi, trouvent un écho dans les valeurs et l’expérience personnelles, pour être incarnées et ainsi, transformées. C’est lorsque ces intersections se rencontrent que naissent les discussions les plus enrichissantes. Parce que même si je parle de Derrida et de Czarniawska, même quand je mobilise les théories les plus arides de Touraine et consort, c’est toujours un peu de moi, dont je parle.
Je ne sais pas ce qui adviendra de notre cercle de Vienne, façon Montréal 2014. Je ne sais pas qui d’entre nous mettra son doc sur la glace un an le temps de faire des enfants, qui suivra son amour au bout de la planète, qui choisira plutôt la consultation, qui se verra écraser par la pression, qui devra aller trouver ailleurs du beurre à mettre sur son pain.
Je sais par contre que, bien qu’il n’y aura jamais d’entrée Wikipedia en notre nom collectif, et si du Cercle de Vienne nous n’avons que l’inspiration, mais pas la prétention, nous avons trouvé le moyen de faire de ce passage ardu et aride un moment d’échange convivial, ressourçant, tant intellectuellement qu’humainement.
Et si mon doc devait se terminer parce que je n’aurais pas eu la note de passage à l’examen de synthèse, et bien il me restera ça. Eux. Qui m’ont appris plus sur la vie que tous les auteurs au programme ne le feront jamais.